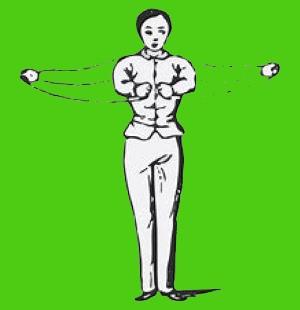introduction 2024
Introduction à la psychanalyse Versions du père.
La question du père a toujours eu une place prépondérante en psychanalyse. Freud lui a donné une place incontournable à partir des mythes d’Œdipe et de Totem et Tabou. Lacan écrit : « Le mythe, c’est ça, la tentative de donner forme épique à ce qui s’opère de la structure[1]. » Le mythe œdipien désigne la place essentielle du père qui vient faire barrage à la proximité incestueuse entre la mère et l’enfant. C’est le père interdicteur.
Avec Totem et Tabou, Freud met en scène le meurtre par les fils du père de la horde jouissant de toutes les femmes. La logique incluse dans ce mythe, c’est qu’il en faut au moins un qui s’en excepte, pour que la règle s’impose et que les rapports entre les femmes et les hommes soient régulés. C’est le père de la loi.
Dans son « retour à Freud », Lacan va se séparer des mythes. Au-delà de la mythologie freudienne du père de la horde ou du père agent de la castration, il forge de nouveaux instruments : la métaphore paternelle fait du père un signifiant, le Nom-du-père, qui vient résoudre l’énigme du désir de la mère. C’est le père comme nom, celui qui assure l’ordre symbolique.
Lacan forge le concept de forclusion qui désigne le rejet primordial de ce signifiant fondamental, le Nom du Père, hors de l’univers symbolique du sujet. Ce défaut donne à la psychose sa condition essentielle et différencie sa structure de celle de la névrose. C’est le père forclos.
Tout au long de son enseignement, Lacan transformera la fonction paternelle, donnant plusieurs versions du père. « Insuffisant à rendre compte des formes contemporaines du lien sexuel, le Nom du Père sera pluralisé par Lacan[2]. » Le pater familias du XXe siècle n’existe plus. Le Nom du père comme fonction f(x) peut alors être remplie par des variables infinies (x) au cas par cas. C’est le père pluralisé.
Le père « perd sa valeur d’universel, du pour tous, et ne se définit que de l’existence et au cas par cas[3]. » Il peut être tenu par n’importe qui à condition qu’il réalise le modèle de la fonction. « Il faut que n’importe qui puisse faire exception pour que la fonction de l’exception fasse modèle[4] » : non pas passer par un modèle de l’universel, mais par une version particulière de chacun. Ce qui fait dire à Lacan : « Le Nom du Père … on peut aussi bien s’en passer à condition de s’en servir[5]. » On peut ainsi décliner plusieurs versions du père dans le discours analytique. A chacun de soutenir la fonction, avec le mode de jouissance qui le caractérise.
Aujourd’hui, pouvons-nous encore parler de l’autorité du père ? Incarne-t-il toujours une dimension symbolique ? Même si le père n’est plus à la hauteur, sa place reste irréductible. Le père lacanien n’est plus le père universel symbole du patriarcat, il se conjugue au « un par un ».
L'introduction à la psychanalyse s'adresse aux étudiants, médecins, psychologues, éducateurs, infirmiers, assistants sociaux et plus largement à tous ceux qui souhaitent s’initier à la clinique et à la théorie psychanalytique freudienne et lacanienne. Elle permet un abord des notions fondamentales, et si elle constitue une formation moins approfondie que celle de l’Antenne proprement dite, elle peut permettre d’y accéder par la suite.
La clinique analytique comporte plusieurs facettes : elle repose sur un fondement théorique ; elle implique une confrontation au concret de la clinique ; elle est une « clinique sous transfert » qui se construit loin de toute objectivation, dans la rencontre avec un sujet. C’est sur cet ensemble que se fonde cet enseignement.
[1] Lacan, J., Télévision, Paris, Seuil, Le champ freudien, 1973, p.51.
[2] Laurent, E., « La psychose ou la croyance radicale au symptôme » Congrès de la NLS, « Le sujet psychotique à l’époque Geek », à Tel Aviv en juin 2012, www.amp-nls.org
[3] Borie, J., « Logique de la pluralisation », UFORCA, bulletin Ironik !, n°31, 2018, www.lacan-universite.fr
[4] Lacan, J., Le séminaire, livre XXII, « RSI », leçon du 21 janvier 1975, inédit.
[5] Lacan, J., Le séminaire, livre XXIII, « Le sinthome», texte établi par J A Miller, Paris, Seuil, 2005, p.136.
Les cinq sessions de 3h chacune comprendront :
Un cours d’introduction aux grands concepts psychanalytiques, d’1h30, laissant large place à la discussion.
Une séance d’1h30 associant des cas cliniques des enseignants, des témoignages et des questions des participants sur leur pratique, (possibilité d'aide des enseignants).
La dernière session sera suivie d’un après-midi de travail clinique et de discussion à partir de l’exposé d’une conversation d’un psychanalyste avec un patient adulte ou enfant. (3h).
Des séquences vidéo pourront venir illustrer les problématiques exposées.
Les cours seront accessibles rapidement après les différentes sessions sur le site web de l’Antenne clinique.
Indicateurs 2023
introduction à la psychanalyse
participants 14
taux de réponse 100%
évaluation des objectifs : 9.27/10
évaluation de la formation : 9.27/10
recommandation de la formation : 100%
Dates et Thèmes des sessions 2024 - plus de précisions à venir
-
Brest le 17 février Gérard Dudognon
Freud le père de la psychanalyse : Œdipe, Totem et Tabou
-
Quimper le 16 mars Christine Rannou :
Relecture de l’Œdipe par Lacan, la métaphore paternelle, le Nom du Père
-
Quimper le 8 juin Laeticia Bourdet :
Le père dans les psychoses
-
Brest le 28septembre Maryvonne Michel :
Pluralisation des Noms du Père
-
Quimper le 14 décembre le matin Claire Zicot :
Du mythe du père Au-delà de l’Œdipe
L’après midi avec la participation d’enseignants de l’antenne clinique :
Les maladies du père
Modification de dates
les sessions auront lieu
en février le 17
en septembre le 28
Dates et horaires des sessions : les samedis
|
Dates |
Lieux |
Horaires |
|
17 février |
Brest |
9h - 12h |
|
16 mars |
Quimper |
9h - 12h |
|
8 juin |
Quimper |
9h - 12h |
|
28 septembre |
Brest |
9h - 12h |
|
14 décembre |
Quimper |
9h - 12h, 14h 17h. |
Soit un total de 18 heures
Adresses
- Brest : Institut de formation Croix Rouge, 460 rue Jurien de la Gravière
- Quimper : Espace associatif, 1 allée Mr Jean-René Calloc’h
Cartel d’enseignement :

Laetitia Billant-Bourdet,
Gérard Dudognon,
Maryvonne Michel,
Christine Rannou,
Claire Zicot.
programmes, objectifs, enseignement
Maison des Associations
1 rue Mgr Calloch
Ergué Armel – Quimper
06 33 54 61 42
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 29 08153 29 auprès du Préfet de région Bretagne
Introduction à la psychanalyse 2024:
Versions du père
Comment s'orienter dans la clinique ? Cette question est au cœur de la pratique individuelle ou institutionnelle de nombreux professionnels de la santé mentale et du secteur médico- social et socio- éducatif.
La question du père a toujours eu une place prépondérante en psychanalyse. Freud lui a donné une place incontournable à partir des mythes d’Œdipe et de Totem et Tabou. Lacan écrit : « Le mythe, c’est ça, la tentative de donner forme épique à ce qui s’opère de la structure1. » Le mythe œdipien désigne la place essentielle du père qui vient faire barrage à la proximité incestueuse entre la mère et l’enfant. C’est le père interdicteur.
Avec Totem et Tabou, Freud met en scène le meurtre par les fils du père de la horde jouissant de toutes les femmes. La logique incluse dans ce mythe, c’est qu’il en faut au moins un qui s’en excepte, pour que la règle s’impose et que les rapports entre les femmes et les hommes soient régulés. C’est le père de la loi.
Dans son « retour à Freud », Lacan va se séparer des mythes. Au-delà de la mythologie freudienne du père de la horde ou du père agent de la castration, il forge de nouveaux instruments : la métaphore paternelle fait du père un signifiant, le Nom-du-Père, qui vient résoudre l’énigme du désir de la mère. C’est le père comme nom, celui qui assure l’ordre symbolique.
Lacan forge le concept de forclusion qui désigne le rejet primordial de ce signifiant fondamental, le Nom-du-Père, hors de l’univers symbolique du sujet. Ce défaut donne à la psychose sa condition essentielle et différencie sa structure de celle de la névrose. C’est le père forclos.
Tout au long de son enseignement, Lacan transformera la fonction paternelle, donnant plusieurs versions du père. « Insuffisant à rendre compte des formes contemporaines du lien sexuel, le Nom-du- Père sera pluralisé par Lacan 2 . » Le pater familias du XXe siècle n’existe plus. Le Nom-du-Père comme fonction f(x) peut alors être remplie par des variables infinies (x) au cas par cas. C’est le père pluralisé.
Le père « perd sa valeur d’universel, du pour tous, et ne se définit que de l’existence et au cas par cas3. » Il peut être tenu par n’importe qui à condition qu’il réalise le modèle de la fonction. « Il faut que n’importe qui puisse faire exception pour que la fonction de l’exception fasse modèle4» : non pas passer par un modèle de l’universel, mais par une version particulière de chacun. Ce qui fait dire à Lacan : « Le Nom du Père … on peut aussi bien s’en passer à condition de s’en servir5. » On peut ainsi décliner plusieurs versions du père dans le discours analytique. A chacun de soutenir la fonction, avec le mode de jouissance qui le caractérise.
Aujourd’hui, pouvons-nous encore parler de l’autorité du père ? Incarne-t-il toujours une dimension symbolique ? Même si le père n’est plus à la hauteur, sa place reste irréductible. Le père lacanien n’est plus le père universel symbole du patriarcat, il se conjugue au « un par un ».
[1] Lacan, J., Télévision, Paris, Seuil, Le champ freudien, 1973, p.51.
2Laurent, E., « La psychose ou la croyance radicale au symptôme » Congrès de la NLS, « Le sujet psychotique à l’époque Geek », à Tel Aviv en juin 2012, www.amp-nls.org
3Borie, J., « Logique de la pluralisation », UFORCA, bulletin Ironik !, n°31, 2018, www.lacan-universite.fr
4Lacan, J., Le séminaire, livre XXII, « RSI », leçon du 21 janvier 1975, inédit.
5Lacan, J., Le séminaire, livre XXIII, « Le sinthome», texte établi par J A Miller, Paris, Seuil, 2005, p.136.
Durée : 18 heures en six demi- journées
Horaires : 9h-12h x 5 ; 14h-17h x 1
Date : 17/02; 16/03; 08/06; 21 /09; 14/12/2024
Type d'action : Action de formation / Formation en présentiel, sauf exception en distanciel
(Pandémie par exemple)
Langue : Français
Qualité et indicateurs de résultats Pour l’ensemble des formations:
Inscrits uforca Brest Quimper 2022 : 117
inscrits introduction à la psychanalyse: 18
évaluation de la formation : 9.18/10
recommandation de l'Uforca Brest-Quimper : 100%
Indicateurs 2023 introduction à la psychanalyse
participants 14
taux de réponse 100%
évaluation des objectifs : 9.27/10
évaluation de la formation : 9.27/10
recommandation de la formation : 100%
Accessibilité :
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes dans cette situation, merci de contacter nos référents handicap ; Jacques Michel 06 48 16 17 58 afin de vous accompagner et de vous orienter au mieux dans votre demande et vos démarches
Lieux et Dates
Brest : 17 février 2024, 28 septembre 2024
-
- IRFSS Croix Rouge, 460 rue Julien de la Gravière.
- Quimper : 16 mars, 8 juin, 14 décembre 2024
Maison des associations – 1 Allée, Mgr Jean-René Calloc’h
Modalité d'entrée en formation :
Première inscription : Admission sur dossier après entretien avec un des enseignants désignés, selon le lieu géographique du demandeur.
Gérard Dudognon 06 86 47 00 34 pour le Finistère nord
Michel Maryvonne 06 73 00 19/ Christine Rannou 06 13 78 65 19 pour le Morbihan et le Finistère sud
Par délégation d’Armelle Guivarch, responsable de l’Antenne Clinique
Réinscription : remplir le bulletin d’inscription et questionnaire de préformation
Délai d'accès : inscription possible jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation.
Tarif de la formation :
- Inscription à titre individuel : 120 euros
- Inscription Demi-tarif pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (joindre justificatif) : 60 euros
- Inscription au titre de la Formation Permanente (FP) : 250 euros
Profils des participants :
- Psychologues
- Psychiatres
- Médecins
- Internes en médecine
- Infirmiers(es) diplômes d’état exerçant en milieu psychiatrique
- Paramédicaux
- Enseignants
- Etudiants
- Travailleurs de la santé mentale du médico-social et du socio-éducatif.
Prérequis :
Niveau 5 (Deuxième année universitaire) / Connaissances en Psychanalyse)
- Des demandes de dérogation peuvent cependant être faites auprès entretien avec la Commission d’organisation.
|
Objectif de la formation et objectifs pédagogiques |
Objectif de la formation : Acquérir l’usage du concept de Père et de ses différentes versions en suivant l’enseignement de Freud et de Lacan afin de montrer sa pertinence dans la clinique des symptômes contemporains et dans l’élaboration de solutions pour un sujet.
- Objectifs pédagogiques du programme :
- Démontrer que le père n’est plus celui dont nous parlait Freud
- Comprendre en quoi le père reste un point central dans la théorie analytique
- Etudier comment le passage du Nom-du-Père à sa pluralisation permet de rendre compte des diverses possibilités d’incarner cette fonction
- Saisir que le père du XXIème siècle n’a plus la valeur universelle du pour tous mais devient une version particulière à chacun
Etudier en première approche ce que sont les « conversations avec un patient » avec un analyste en milieu hospitalier.
|
Contenu de la formation |
Déroulé des journées
Evaluation de la progression des apprentissages par les participants 9h-9h10
Les participants pourront revenir sur les séquences précédentes en interrogeant les enseignants pour éclaircir des points théoriques et cliniques.
Cours théorique sur le corps et la pulsion 9h10-10h10
Pause . 10h10-10h20
Exposés par les enseignants de cas cliniques de leur pratique ou de la littérature analytique, pour illustrer le cours théorique. 10h20- 11h20
Exposé d’un cas clinique par un participant 11h20-11h55
Des participants exposeront à partir de leur propre pratique, un travail clinique, élaboré avec un enseignant tuteur et faisant ensuite l’objet d’un écrit.
Présentation de la session suivante : contenu et lieu. 11h55-12h.
( dernière session ; l’après-midi de 14h à 17h : Enseignement des conversations cliniques avec un patient)
Progression pédagogique du programme :prochainement
17 février 2024
16 mars 2024
8 juin 2024
28 septembre 2024
14 décembre 2024
-Matinée
-Après midi : Enseignants de l’Antenne Clinique : Introduction aux « Enseignements des conversations cliniques avec des patients » comme apport théorique et clinique dans la formation des cliniciens. Etude d’un cas de conversation clinique avec
|
Organisation de la formation |
Equipe pédagogique :
Les enseignants pratiquent la psychanalyse et sont membres de l’Association de La Cause Freudienne
Coordination de la formation :
Dr Armelle Guivarch, Psychiatre, Membre de l’Ecole de La cause Freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse
Enseignants :
Mme Maryvonne Michel, psychologue clinicienne, membre de l’Association Cause Freudienne en Val-de-Loire-Bretagne.
Mme Christine Rannou, psychologue clinicienne membre de l'Association de la Cause Freudienne en Val de Loire- Bretagne
Membres associés du cartel d’enseignement :
Mme Laetitia Billant-Bourdet, psychologue clinicienne, membre de l’Association de la Cause Freudienne en Val-de-Loire-Bretagne
Mme Claire Zicot, psychologue clinicienne, membre de l’Association de la Cause Freudienne en Val-de-Loire -Bretagne
Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des inscrits dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation.
- Cours magistraux et exposés théoriques
- Séminaires pratiques avec exposition et discussion de cas.
- Bibliographie recommandée
- Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation sur l’espace membre dédié du site web www.antennecliniquebrestquimper.com
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Évaluation des acquis
- Rédaction et discussion de cas clinique de la pratique
- Évaluation de la satisfaction :
- À la fin des journées de formation (à chaud).
- 30 jours après la formation (à froid).
- Attestation d’études cliniques sous réserve d’avoir rempli les conditions de présence et de participation active
- Attestation de suivi de l’action de formation
Date de dernière mise à jour : 04/06/2024